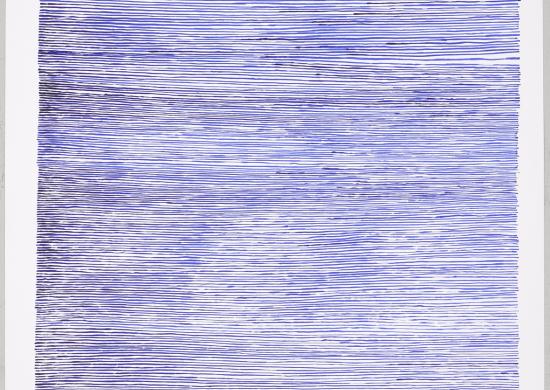Une spécificité : les liens entre Jean Schlumberger et Maria Van Rysselberghe
Le Centre littéraire André Gide-Jean Schlumberger est en fait composé de deux fonds d’origines différentes, mais pourtant parfaitement complémentaires dans leur composition : le Cabinet Jean Schlumberger installé aux Treilles depuis l’origine par A. Gruner Schlumberger et le fonds documentaire initialement propriété de J.-P. Dauphin, ancien directeur des archives de Gallimard, et enrichi depuis par les dons et les cessions de la Fondation Catherine Gide qui constituent un apport considérable et précieux aux deux fonds initiaux.
Le Cabinet Jean Schlumberger
Dans ce Cabinet, où n’a malheureusement jamais travaillé notre écrivain, sont regroupés les livres composant sa bibliothèque personnelle et les dédicaces permettant de dresser une sorte de géographie des sympathies littéraires de notre auteur. On y trouve également, cela va de soi, toute sa production littéraire : ses ouvrages, manuscrits autographes, dactylographiés ou imprimés, ses articles publiés dans les journaux de l’époque (questions de société, questions religieuses ou politiques) ainsi que ses notes de lectures et ses carnets manuscrits auxquels il convient d’ajouter une somme importante de correspondances que je vais détailler un peu plus ci-après…
Une bonne partie de ces documents n’a fait l’objet d’aucune publication à ma connaissance, je pense bien évidemment aux correspondances, mais aussi à certains « carnets » de Jean Schlumberger, sorte de journal de l’auteur. Ces carnets ont fait l’objet, pour moitié, d’un dépôt à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet en 1974 par Joseph Breitbach alors chargé de la « gérance des œuvres littéraires » de Jean Schlumberger. Suite à une convention signée durant l’été 1992 entre la présidente de la Fondation des Treilles et le conservateur de la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, un échange de microfiches a eu lieu à l’automne de la même année ce qui permet, dans les deux établissements, la consultation de la totalité de ces carnets.
Nous possédons les trois premiers (de 1912 à 1930) et le septième (de 1946 à 1948, la BLJD possédant les carnets IV à VI [de 1931 à 1945]).
Je m’arrête un petit instant sur les correspondances du Cabinet évoquées plus haut : correspondances échangées avec sa famille (notamment son épouse Suzanne Weyher, peintre et élève de Théo Van Rysselberghe) et les écrivains appartenant à la galaxie NRF de l’époque comme André Gide, Roger Martin du Gard, Jacques Copeau ou Jean Paulhan (dont les originaux des 300 lettres sont conservés à Doucet : nous ne possédons que les photocopies). La correspondance avec son épouse qui s’étale de 1899 à 1924 (date du décès de Suzanne) et comprend environ 2600 lettres est une mine de renseignements sur la vie littéraire et artistique de l’époque, notamment la naissance de La NRF et les relations parfois mouvementées entre les écrivains… On y trouve également des détails intéressants sur la Première Guerre mondiale, enrichis par les différents documents ayant trait aux états de service de Jean Schlumberger pendant cette période.
La correspondance envoyée et reçue par Jean Schlumberger est extrêmement variée sur le plan littéraire, mais on ne retiendra peut-être que quelques noms en raison de l’importance des échanges : Auguste Anglès, Henri Ghéon, Roger Martin du Gard, Anna de Noailles, Jacques et Isabelle Rivière ou encore Jean Paulhan, correspondance évoquée plus haut.
En sus de cette masse documentaire sont conservés dans le Cabinet des affiches de représentations théâtrales (Vieux Colombier…), des dessins (Elie Grékoff, Suzanne Schlumberger…), des tableaux de Suzanne Schlumberger et deux bustes en bronze et en cire représentant notre auteur et son épouse qui sont l’œuvre de Théo Van Rysselberghe.
Ce fonds, inventorié aux débuts des années 80, est resté très longtemps inexploité et ne s’est ouvert qu’à partir de l’achat du fonds complémentaire.
Le fonds « J.-P. Dauphin »
Il existait un inventaire papier de ce fonds divisé en 6 tomes et répartissant ces 20 000 unités bibliographiques en trois grands domaines généralistes : Littérature (pour 80 % du fonds), Histoire (environ 10 %) et enfin Civilisation (idem). Il se compose essentiellement d’ouvrages de littérature française, pour une période s’étalant de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e et les auteurs représentés sont principalement des auteurs de la maison Gallimard, auteurs français, mais également étrangers. Il s’agit souvent de monographies en édition originale avec des exemplaires dédicacés ou numérotés. L’histoire éditoriale pour un même ouvrage est souvent complète avec jeux d’épreuves, brochés ou mobiles, exemplaires hors commerce, etc., comme c’est le cas notamment pour les « Pléiades », conservées en usufruit par son ancien propriétaire, et reçues au décès de celui-ci en 2013 (exemplaires publiés sous la direction de Jacques Schiffrin).
En sus des monographies, nous possédons, dans la dernière salle, une collection de journaux et de revues qui complète bien le panorama de l’histoire intellectuelle de cette époque. Y figure bien évidemment La Nouvelle Revue française, la revue Fontaine, mais également celle des Temps modernes ou d’autres numéros plus disparates de revues artistiques ou littéraires apparemment difficiles à trouver en accès libre au dire des chercheurs venus travailler dans ce fonds, je pense par exemple au Bulletin de la vie artistique, à la revue Art et médecine, à la Renaissance de l’art français et des industries du luxe ou à L’Âge nouveau qui, comme leurs noms ne l’indiquent pas, ont souvent publié des articles de plumes prestigieuses, articles peu connus donc intéressants pour nos chercheurs…
Le fonds Histoire regroupe, quant à lui, énormément d’ouvrages sur les deux guerres mondiales ainsi que des documents assez rares, comme les minutes du procès Pétain, des tracts et des lettres de propagande ou des articles de presse relatant les faits marquants de cette époque troublée…
En explorant plus avant cette bibliothèque si particulière, on pourrait retracer l’histoire de la collection et des passions qui ont animé son ancien propriétaire. En effet, il existe plusieurs fonds dans le fonds…
Un fonds « Céline » dont J.-P. Dauphin était l’un des spécialistes, avec notamment les plaques d’imprimatur de Bagatelles pour un massacre et une masse de documents concernant cet auteur (plus de 300 occurrences dans le catalogue !)
Un fonds « Surréalisme » avec quelques documents rares sur « L’affaire Aragon/Breton » (Frontrouge et Un cadavre), quelques tracts et affiches, des lettres de René Crevel ou d’André Breton…
Un fonds « Graphisme Massin », du nom du célèbre typographe de Gallimard qui a fait l’objet d’une rétrospective à la bibliothèque du Centre Pompidou. Moins connue peut-être, la typographe Jeanine Fricker (1925-2004), disciple de Massin et directrice artistique chez Gallimard, assure la direction graphique puis le secrétariat général de la grande collection L’Univers des formes,voulue parAndré Malraux.
Un fonds « Histoire du livre et de l’édition » qui, en sus d’ouvrages de référence, est riche de catalogues de librairies et d’éditeurs auxquels il convient d’ajouter des catalogues de ventes, de bibliothèques ou d’autographes…
Un fond « Partitions » qui reste encore à explorer : opéras, opérettes, drames lyriques, musiques de scène…
Enfin, plus singulier encore, le fonds « Albert Flament » dont l’histoire est un peu particulière, mais qui nous vaut la possession d’une collection de lettres autographes dont la plupart sont, à ma connaissance, inédites, puisqu’il s’agit de correspondances entre des écrivains et des artistes avec leur « mentor »…
Albert Flament (1877-1956) est un journaliste, critique d’art et romancier qui a collaboré à diverses revues et journaux comme Femina ou la Revue de Paris dont nous possédons certains exemplaires. Auteur de pièces de théâtre et de romans (nous possédons manuscrits et tapuscrits de ses ouvrages) il est surtout intéressant pour nous de par les relations qu’il entretenait en tant que critique avec les écrivains et artistes de son époque – d’où une correspondance importante. Je citerai juste quelques documents : échanges avec Marcel Proust, billets de Colette, lettres d’Antonin Artaud, de Gabriel Audisio, Marcel Aymé, Georges Bataille, Alphonse et Lucien Daudet, Paul Fort, Michel Leiris, Romain Rolland, Paul Valéry ou, côté artistes, une carte de visite avec quelques mots de la main de Camille Claudel, lettres de Marie Laurencin, Maurice Denis, Valentine Hugo, Paul Signac, André Rouveyre, côté théâtre, une photographie dédicacée de Sarah Bernhardt, billets de Réjane, Cécile Sorel… la liste est longue.
Le fonds André Gide issu des dons et cessions de la Fondation Catherine Gide
Première donation :
Nous sommes allés chercher en septembre 2013 à Cabris (Alpes-Maritimes) un fonds littéraire qui nous a été donné par la Fondation Catherine Gide, suivant la volonté de cette dernière qui ne souhaitait pas que la collection soit dispersée à tout vent à son décès. Ce fonds se compose essentiellement d’ouvrages d’André Gide et d’études le concernant, en langue française majoritairement, mais également en langues étrangères. La plupart de ces monographies sont des éditions originales ou font l’objet d’exemplaires numérotés. Certains sont dédicacés par l’auteur, le plus souvent à l’intention de proches comme sa fille Catherine ou bien la mère de celle-ci, Élisabeth Van Rysselberghe sans oublier évidemment la Petite Dame, Maria Van Rysselberghe. Certains titres d’André Gide (comme Isabelle ou Les Nourritures terrestres) sont présentés sous forme de livres d’artistes (environ 70) avec des illustrations d’auteurs tels André Rouveyre ou Marie Laurencin. En lien bien sûr avec notre auteur nous avons également récupéré, sur les conseils éclairés de Peter Schnyder, l’essentiel de la bibliothèque anglophone d’Élisabeth Van Rysselberghe ainsi qu’environ deux cents numéros de revues comme Mercure de France, Les Cahiers du Sud ou Les Temps modernes qui nous permettront de compléter la collection déjà existante…
Enfin, s’ajoutent à ce panorama un buste en plâtre représentant André Gide, trois masques mortuaires (d’après les recherches d’Olivier Monoyez, il s’agirait de Dante, Goethe et Beethoven) et une photographie sous cadre de Rupert Brooke, poète anglais et premier amour d’Élisabeth Van Rysselberghe.
L’ensemble forme une masse d’environ 1300 unités bibliographiques dont la richesse et la diversité permettent de réunir en un seul lieu un éventail représentatif de l’œuvre et de l’univers d’André Gide.
Seconde donation :
En 2015, la Fondation Catherine Gide a fait un deuxième don de documents ayant trait à Jean Schlumberger, lettres et photographies. Ce lot comprend une cinquantaine de correspondances entre Jean Schlumberger et André Gide, mais également avec Maria et Élisabeth Van Rysselberghe ou Roger Martin du Gard et Jean Paulhan. Les photos, au nombre de 24, sont essentiellement des photos représentant la famille Schlumberger et les enfants Copeau.
Acquisition :
4 lots ont fait l’objet d’une acquisition à la Fondation Catherine Gide à l’automne dernier.
Lot « Gide et les peintres » : un ensemble de correspondances entre Gide et des peintres comme Jacques-Émile Blanche, Paul Signac, André Rouveyre, James Ensor ou Raoul Dufy.
Lot « Gide et les écrivains » :
Ensemble de correspondances échangées entre Gide et des écrivains de Hesse à Rilke, en passant par Camus, Mauriac, Sartre ou Blum.
Lot « De Me Ipse » :
Dossier de notes manuscrites et chronologiques pour ses mémoires (Si le grain ne meurt)
Lot « Le Procès » :
Manuscrit et documents tournant autour de la pièce de théâtre tiré du roman de Franz Kafka. Notes manuscrites et dactylographiques avec quelques corrections autographes de Gide.
Sauvegarde, conservation et… exploitation
La sauvegarde et la conservation d’un fonds littéraire peuvent paraître vaines si ce fonds n’est pas exploité… C’est pourquoi la Fondation a créé un prix attaché à ce centre de recherches et continue à réfléchir sur sa mise en valeur notamment en réalisant des synergies avec des institutions complémentaires au niveau national ou international. C’est seulement à cette condition que nous pourrons assurer la vitalité et la pérennité du Centre André Gide-Jean Schlumberger.
C’est de ces fonds très riches et très précieux évoqués avec vous que sont extraits les documents suivants que je voudrais vous lire pour illustrer les relations entre Maria Van Rysselberghe, dont on a beaucoup parlé lors de ces journées, et Jean Schlumberger que l’on connait moins ici. Un grand merci à Olivier Monoyez qui s’est associé à moi dans cette entreprise et qui a été à l’origine de la découverte de nombreuses pépites de nos fonds !
Maria Van Rysselberghe et Jean Schlumberger
Lorsque j’ai parcouru le premier panneau de la très belle exposition de Jean-Pierre Prévost, j’ai immédiatement pensé que la description qu’il faisait de Maria aurait aussi bien pu s’appliquer à Jean. Similitude des caractères, similitude des âmes… discrétion et humilité de ces deux écrivains qui seront pourtant tellement importants pour le monde des lettres de cette période…
C’est une véritable amitié littéraire qui liera ces deux personnages hors du commun pendant plus d’un demi-siècle puisqu’elle s’étalera de 1904 à 1959, date du décès de Maria.
Dans Rencontres, publié en 1968, J. Schlumberger évoque ainsi son premier contact avec la Petite Dame qu’il appellera Tit dans ses écrits, comme un véritable familier… :
« Un certain jour de novembre 1904, rentré brusquement à Paris et ne sachant où rencontrer Gide que je souhaitais revoir, je m’étais demandé s’il ne serait pas descendu chez ces amis Van Rysselberghe dont il prononçait souvent le nom. Je trouvai leur adresse dans je ne sais quel Bottin et j’allai sonner à la porte du pavillon qu’ils occupaient dans une impasse de la rue Laugier. Une femme vive et menue vint m’ouvrir et m’introduisit dans un vaste atelier où travaillait un peintre. J’expliquai mon affaire. On me renseigna avec cette cordialité qui met tout de suite le visiteur à l’aise et qui tranche sur le quant-à-soi sec et méfiant des gens de Paris. Non seulement je retrouvai facilement Gide, mais du même coup j’avais trouvé cette maison de la rue Laugier dont je devais bientôt devenir un familier ; et j’avais trouvé les précieux amis avec lesquels j’allais être lié pour le reste de nos vies. »
Jean Schlumberger, Rencontres, 1968.
Jean relatera également cette rencontre dans une lettre inédite de nos fonds à son épouse Suzanne Weyher, peintre amateur, élève de Théo Van Rysselberghe et décédée prématurément à Saint-Clair en 1924 à l’âge de 46 ans. Le 16 novembre 1904, voici ce qu’il écrit :
« Excellente journée à Paris dimanche. Vu des choses excellentes au Salon d’Automne. J’étais avec André Gide qui m’a donné quelques indications précieuses et révélatrices. N’importe tous ces peintres on les reverra et je pourrai te les faire remarquer. Ensuite il m’a mené chez les Van Rysselberghe, peintre pointilliste, intérieurs exquis, femme charmante, accueillante. Nous les reverrons souvent ; ce sera une relation très agréable. »
Lettre inédite, Fonds Schlumberger, Fondation des Treilles
Voilà donc une rencontre qui démarre sous les meilleurs auspices… Jean Schlumberger fera de fréquents séjours chez les Van Rysselberghe à Saint-Clair et de même Maria séjournera à plusieurs reprises rue d’Assas chez notre écrivain et au manoir de Braffy dans le Calvados. C’est souvent au cours de ces séjours qu’auront lieu les échanges littéraires entre nos deux protagonistes et très souvent Gide se joindra à eux, chacun proposant aux deux autres la lecture de ses écrits et attendant en retour les commentaires de chacun.
Il est d’ailleurs amusant de faire une lecture croisée de l’ouvrage de Jean (Notes sur la vie littéraire) et des Carnets de la Petite Dame pour s’apercevoir que les deux récits sont parallèles et donc, on le suppose, fidèles à la réalité… Ainsi, en juin 1939 :
« 6 juin. Lecture Stéphane à Tit et à Gide. Ils sont accablés d’ennui par le début et ne se réveillent vraiment que dans la seconde moitié, il est vrai pour déclarer que cela dépasse tout ce qu’ils avaient attendu. Excellentes critiques grammaticales de Gide. »
J. Schlumberger, Notes sur la vie littéraire, p. 220.
De même, Maria dira de cette lecture :
« Voici de nouveau huit jours que je n’ai plus rien noté dans ce cahier. Mobilisée chaque jour par une vieille amie malade, je ne le voyais que le soir, et si fatiguée que j’étais comme absente. Un jour pourtant, nous sommes allés chez Jean qui voulait nous lire son dernier livre, qu’il vient de terminer. Première séance avant le diner — deuxième séance après et nous ne nous sommes quittés que fort tard. Je résume ce que Gide a dit à Jean après la lecture : “Mon vieux, le récit de ce drame que tu as très bien mené est fort beau et d’un pathétique très particulier qui t’appartient, c’est une œuvre très personnelle, mais une grande partie du récit qui le précède me semble ennuyeuse et inutile, et pourrait très bien décourager le lecteur.” En sortant de chez Jean, il me dit encore : “Jean devrait miser sur le sublime, c’est un grand compliment que je lui fais là-c’est l’affaire de bien peu. Il s’embarrasse de trop de logique dans ses explications, et plus son récit est coulant, parfait, bien poncé moins il arrête le lecteur, moins il arrive à le capter.” »
Maria Van Rysselberghe, Cahiers de la Petite Dame, tome III.
La Petite Dame est souvent plus nuancée que Gide dans ses critiques. Comme le remarque Jean Schlumberger dans ses Notes à propos de Jalons en février 1942 :
« 23 février. Dans une lettre de Gide à propos de Jalons, il écrit : “Certains [articles] sont excellents. On ne pourrait leur reprocher qu’une chose : c’est de ne soulever jamais la protestation. On est contraint d’acquiescer sur toute la ligne, tant, lors même que tu es le plus hardi, tu l’es avec modération.” Ces quelques mots sont bien caractéristiques. Impossibilité où est Gide de quitter le terrain de l’œuvre d’art, de l’auteur qui souhaite briller. Aucun souci de l’utile, des chances qu’on a de telle ou telle manière d’agir efficacement sur les gens : ce n’est pas en soulevant des protestations qu’on soutient les courages. Mais évidemment, dans vingt ans, c’est le paradoxal qui gardera le sel. […]
24 février. Justement je relève dans une lettre de la Petite Dame des appréciations bien plus pénétrantes que celles de Gide. Elle parle de mes “efforts pour ennoblir un chacun dans ses activités et ses réflexions”. Et à propos de méthode : “cette culture dense, qui ne se montre jamais pédante et toute subordonnée à une volonté de mise au point pour faire avancer notre esprit et seulement pour cela. Cela n’est plus courant et vous est très particulier. Je les ai particulièrement aimés (ces articles) parce qu’ils vous ressemblent si bien.” »
Jean Schlumberger, Notes sur la vie littéraire, p. 238.
A contrario, pour d’autres sujets, peut-être plus sensibles, André et Maria se rejoignent dans les remarques faites à Jean. Ainsi, Jean Schlumberger note en 1946 :
« Gide et la Petite Dame chinent ma chronique sur le communisme : “Curieux manque de logique… des adjectifs vraiment déplacés… indéfendables… Excuse-nous de le dire…” On retrouve le journal. Avec stupeur je m’aperçois qu’ils n’ont pas compris que tout le texte était ironique ! Ce n’est pas la première fois qu’ils se montrent des lecteurs plus obtus que les gens de la rue. Partis sur une fausse piste, ils n’ont pas la docilité de se laisser ramener sur la bonne. Leur totale méprise, jadis, quand je leur ai lu Stéphane. Épaisseur d’incompréhension, par l’intelligence trop rapide. »
Ibid., p. 283.
Il y a donc parfois dans ce trio d’écrivains une incompréhension, mais Jean est toujours très à l’écoute des remarques qui lui sont faites. En 1948, il écrit à la date du 17 avril :
« Gide étant occupé avec Amrouche et Denoël, c’est à la Petite Dame que je fais ma lecture. Je le préfère ainsi, car ce dont je suis curieux c’est de son impression purement sentimentale. Et elle met très justement le doigt sur les défauts du Liseron : “langage de vieux monsieur ; il faudrait rajeunir la lettre pour que la banalité de la donnée en fût relevée”. Mais elle m’a paru très contente de Carlo. » [Carlo, Liseron et Léopard sont trois lettres sur les passions, qui seront reprises dans… Passion, justement, et dans le tome VII des Œuvres de Jean Schlumberger.]
Ibid., p. 298.
Mais derrière la critique la louange n’est jamais très loin… La même année, au mois d’octobre, Jean écrit :
« 28 octobre. Le Vaneau s’est dégarni. La Petite Dame me saute au cou et me donne un baiser supplémentaire pour mes Pierres de Rome. À l’en croire je n’ai jamais rien écrit de si excellent et de si personnel. Gide fait une apparition, coiffé d’un bonnet de nuit, très chancelant, s’étendant aussitôt sur la chaise-longue. Lui aussi est très élogieux. »
Ibid., p. 303.
L’année suivante, à la date du 15 mai, Jean note :
« Repris chez la Petite Dame le manuscrit de mes souvenirs. J’attendais avec curiosité ses appréciations. Ce n’est pas qu’elle soit transportée, mais elle est contente. “L’unité de ton y est”, dit-elle “et c’est le principal”. Tous les portraits lui semblent justes. Elle affirme que personne, notamment Gide, ne peut être chagriné, et que, étant donné mon parti pris de non-confidence, elle n’est arrêtée par aucun soupçon d’hypocrisie. Remarques de détail, toutes justes et utiles. »
Ibid., p. 316.
De même, dans un passage du Cahier des Saisons d’avril 1958, Maria parlera ainsi de Jean Schlumberger :
« Je retrouve dans une très ancienne page de journal cette petite note sur Jean Schlumberger : Il me semble toujours que chez Jean Schlumberger la découverte psychologique procède bien plutôt de la seule intelligence que de l’esprit d’observation ou de l’instinct créateur. Pourtant Schlumberger sait observer : ses personnages vivent ; mais les détails qui caractérisent, toujours hautement significatifs, sont le fruit du raisonnement et de l’imagination plus que de l’observation directe. Ce qui sollicite l’intérêt de l’auteur, c’est d’abord, me semble-t-il, un cas, un cas particulier, curieux (et quelle originalité de Jean dans ce domaine !) ; puis il incarne ce cas, invente ensuite le comportement de son personnage, ce qui en déterminera avec précision le caractère. Mais qu’importe la marche de la découverte ? L’essentiel est de tenir en éveil l’intérêt du lecteur, et Schlumberger n’y manque jamais. Grâces lui soient rendues par une amie reconnaissante. »
Maria van Rysselberghe, Cahier des Saisons, avril 1958.
À la lecture de ces différents extraits, il me semble voir une certaine connivence entre Jean et Maria, une relation de confiance qui se vérifie par certaines confidences entre les deux personnages, à propos de Gide par exemple…
Ainsi en août 1938, après la mort de Madeleine Gide en avril, Jean note :
« Sous la charmille, Tit me parle de Gide et de Madeleine. Je déplore qu’il n’écrive pas un petit livre sur elle (Madeleine), un portrait. Elle me répond “Je ne crois pas qu’il le fasse. Ce qu’il écrira ce sera plutôt pour expliquer son attitude à lui. Sa préoccupation est : il manquera quelque chose à ma figure”. Je n’aurais pas osé dire la chose aussi cruellement… »
J. Schlumberger, Notes, p. 218.
Ou, petite anecdote amusante relatée par J. Schlumberger le 12 mars 1950 :
« La Petite Dame assez pointue sur le compte de Gide. “L’importance démesurée attachée à la moindre de ses envies, voilà où se traduit sa sénilité” dit Maria. Gide s’était fait envoyer de Tunisie une caisse de dattes qui est arrivée à Paris depuis son départ. La Petite Dame, n’ayant personne qui pût assurer la réexpédition, a ouvert la caissette et l’a partagée avec Alix. C’était d’ailleurs des dattes collantes et non pas sèches comme les aime Gide. Or, par trois fois, Gide lui a écrit, se lamentant sur ses dattes qu’il aurait eu tant de plaisir à manger quand il se réveille la nuit – des plaintes de petit garçon gâté. »
Ibid., p. 324.
Un peu plus tard ce sera au tour de Jean de remarquer, avec délicatesse, le déclin progressif de Maria. Ainsi dans Jean Schlumberger et La NRF paru aux Éditions L’Harmattan, Pascal Mercier publie des inédits de Jean Schlumberger, probablement extraits de nos fonds et notamment celui-ci où Jean, âgé de 80 ans, écrit au mois de mai 1957, soit deux ans avant la mort de Maria :
« Chez la Petite Dame, sur qui j’aimais à porter les yeux comme sur une image rassurante, l’équilibre est rompu entre la vigueur de l’esprit et celle du corps. Depuis six mois elle disait : “Je ne me plains pas, j’ai le sentiment de raisonner aussi bien que par le passé. Mais je perds la mémoire de tout ce qui est récent. J’ai besoin de tout noter.” Encore cet hiver elle a composé – disons plutôt mis au point – une Esquisse pour un portrait de Jacques Copeau, qui n’est guère moins aigu que ses précédents portraits. Mais depuis lors la descente est rapide. Sur les livres que je lui apporte chaque dimanche, je doute qu’il y en ait un qui ait retenu son attention. Elle se borne à un jugement passe-partout : “C’est bien écrit ; ce n’est pas bête ; mais il n’y a plus jamais, dans aucun de ces romans, la création d’un caractère.” – Observation juste, mais qu’il lui arrive trop souvent de répéter sans avoir ouvert le livre – comme elle me demande à chaque visite : “Est-ce que Monique Hoffet est rentrée à Paris ?” alors qu’elle l’a vue la veille.
Mais il y a plus grave : certaines altérations que Pierre Herbart signale depuis des mois. C’est ainsi qu’elle a pris sa malheureuse cuisinière turque comme souffre-douleur – jusqu’à aller, sur la pointe des pieds sonner à la porte, puis rentrer rapidement dans le salon. Au bout de quelques secondes, elle ressort : “Denise, on sonne”. Et quand Denise annonce qu’il n’y a personne, elle a le plaisir de l’attraper : “Naturellement. Vous n’avez pas couru assez vite.” »
En plus de cette complicité intellectuelle et de cette belle amitié littéraire, il existe un attachement véritable entre ces deux êtres et pour illustrer mon propos, je voudrais vous lire un extrait de la lettre envoyée par Jean Schlumberger à Maria au moment du décès de Théo en décembre 1926, lettre reproduite entièrement par Jean-Pierre Prévost dans son exposition : « Chère bonne Tit, Si je ne suis pas tout en larmes comme mes deux petits, je n’en ai pas le cœur moins serré. On ne remplace pas des amis comme celui-là… J’aurais voulu être là pour vous aider, pour donner la moindre marque d’affection à cet ami de qui j’en ai beaucoup reçu. Votre patience et votre courage lui ont épargné le désarroi où sa vie risquait de finir tristement… De toute ma vieille tendresse, je vous embrasse, si chère Philomène. Jean » (Philomène était le deuxième prénom de Maria. De même, Jean Schlumberger signera certaines de ses lettres à la Petite Dame par Nicolas, qui est en réalité son troisième prénom.)
Je terminerai enfin, toujours pour illustrer cette affection mutuelle, par la lecture des deux portraits que chacun a faits de l’autre, avec une lucidité et une connaissance qui ne peut exclure cette part de tendresse dans leurs relations. Depuis longtemps Roger Martin du Gard pousse la Petite Dame à faire un portrait de Jean Schlumberger. Voici ce qu’elle en dit dans ses Cahiers en 1941 :
« Jean n’éblouit pas, ne s’impose pas, son portrait ne peut se faire que lentement, par petites touches, on découvre Jean, par hasard, et comme malgré lui : tenez sur bien des sujets, il est vraiment érudit, mais on peut vivre des années à côté de lui sans le savoir ; il ne fait jamais montre de rien, il ne sort ses connaissances qu’utilement pour faire avancer une discussion ou donner un renseignement ; c’est fortuitement qu’on apprend, par exemple, qu’il lit le russe ; si on cherche devant lui à se rappeler un vers anglais, on s’aperçoit qu’il sait toute la poésie par cœur. Ce n’est pas qu’on s’en étonne, ce serait injurieux, mais on pense avec admiration : et il connait cela aussi, et encore ça ! C’est que, voyez-vous, tout le bagage intérieur de Jean n’ajoute pas beaucoup à sa présence, à son pittoresque. Mais combien cela élargit le champ de ses références, combien cela nourrit sa méditation ! C’est là que brûle le meilleur des forces de Jean, là qu’est pour moi sa véritable originalité : cette obstination entêtée qu’il met à tordre un sujet jusqu’au fond, à lui faire donner sa portée la plus générale, sa plus haute signification morale, et avec une adresse consommée qui ne laisse perdre ni une miette des réalités, ni une possibilité d’approfondissement. […] »
Maria van Rysselberghe, Cahiers de la Petite Dame, tome III, p. 241.
Jean n’est pas un personnage plastique, on le raconte petit à petit, en cherchant ses empreintes autour de lui ; ainsi sa chambre est partout, tout de suite, comme la cagna la mieux organisée, la plus utilement aménagée pour le travail. L’essentiel, c’est qu’il ait assez chaud, qu’il soit bien installé, pour écrire avec le nécessaire à portée de la main ; aucune trace de mollesse ; l’indispensable luxe, c’est un petit bouquet de fleurs sur sa table, comme s’il avait besoin de quelque chose de vivant sous les yeux. À Paris, le bouquet voisinait avec quelque friandise que ses filles renouvelaient, j’aimerais penser qu’il y veillait aussi et que c’est une faiblesse qui ne doit rien à l’hygiène. La discrétion et la générosité de Jean ont des tours assez uniques ; il ne fait pas des cadeaux, il dépose des présents, c’est ainsi qu’à Colpach et sans jamais le dire, il constituait petit à petit, à chacune de ses visites une bibliothèque musicale, celle qu’il était logique de trouver là sur un piano. Il donne ce qui fait plaisir, mais plus encore ce qui manque à une harmonie générale, ce qui est utile dans un ordre supérieur. Durant des jours, je me suis extasiée devant lui sur la grâce particulière des bouquets qu’on voyait au salon de la Messuguière sans me rendre compte qu’il en était l’auteur. Je m’en veux, du reste, de ne pas l’avoir compris tout de suite ; ses bouquets lui ressemblent — on ne peut pousser plus loin l’ingéniosité dans l’utilisation d’un minimum – nous étions en hiver – ces bouquets étaient composés de plaques de mousse, de grêles brindilles, de feuilles mortes, de quelques fleurs bien disposées : tout ce qu’on trouve au bord de la route en battant les buissons d’un œil attentif. C’est tout près de n’être qu’une maigre récolte pour une leçon de botanique, mais non, c’est un assemblage décoratif d’un goût parfait, fait avec la hardiesse et la fine économie des Japonais et une grande adresse de main. Les curiosités naturelles ont en lui les échos tendres, elles en appellent à la fois à son appétit de savoir et à ses instincts d’art.
Ce portrait ne sera à ma connaissance jamais publié en dehors de ses Cahiers, comme elle a pu le faire par exemple dans Galerie privée, avec d’autres écrivains…
Ce ne sera pas le cas pour le portrait d’elle qu’en fit Jean Schlumberger, qui paraitra d’abord dans Le Figaro littéraire du 5 décembre 1959, au moment de son décès, puis sera repris dans Alyscamps (tome VII des Œuvres) et dans Rencontres en 1968.
Avant de reproduire ce bel éloge funèbre, voici ce que Jean écrira en préambule dans Rencontres :
« Mme Théo », « la Petite Dame », ces noms reviennent si souvent dans nos correspondances, ils désignent une personnalité si particulière, si hors série, qu’ils garderont toujours leur accent pour tous ceux qui l’ont approchée. Un jour, à une « décade » de Pontigny, apprenant qu’une personne aux goûts si décidés, entourée de tant d’écrivains, n’avait jamais publié une ligne, le critique anglais Lytton Strachey s’écria : « Comme vous êtes originale ! » Il ne croyait pas parler si juste. Mais cette originalité littéraire finit par succomber à la constance du cœur, et j’ai toujours estimé que le court récit composé par notre amie presque septuagénaire comptait parmi les plus parfaits que l’autobiographie ait inspirés. « Il y a quarante ans», dit le titre, et pour être resté enfermé pendant la moitié d’une vie dans une âme où rien ne s’altérait, cet épisode a conservé la fraîcheur d’émotions éprouvées la veille. Un jour on placera ce petit ouvrage au rang qu’il mérite et l’on découvrira quel mémorialiste scrupuleux son auteur se révèle dans ses carnets de notes.
Jean Schlumberger, « Adieu à la Petite Dame » (Le Figaro littéraire, 5 décembre 1959)